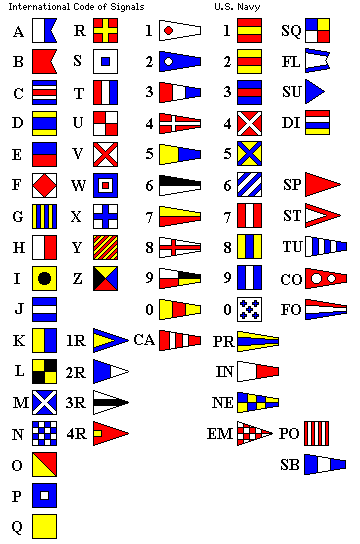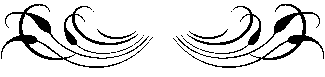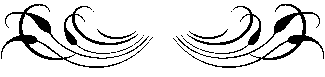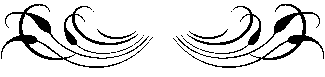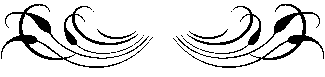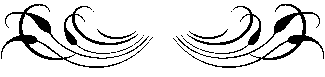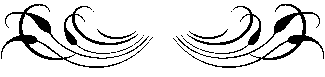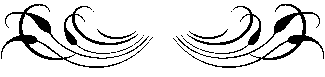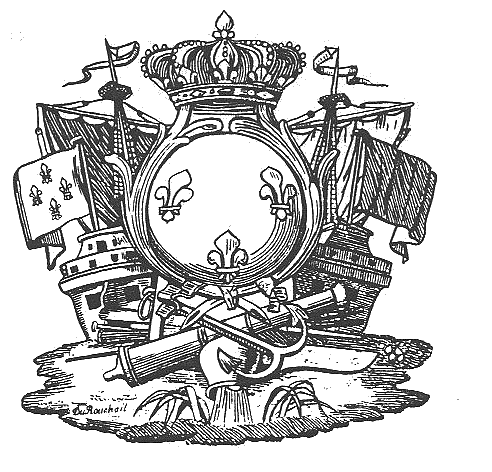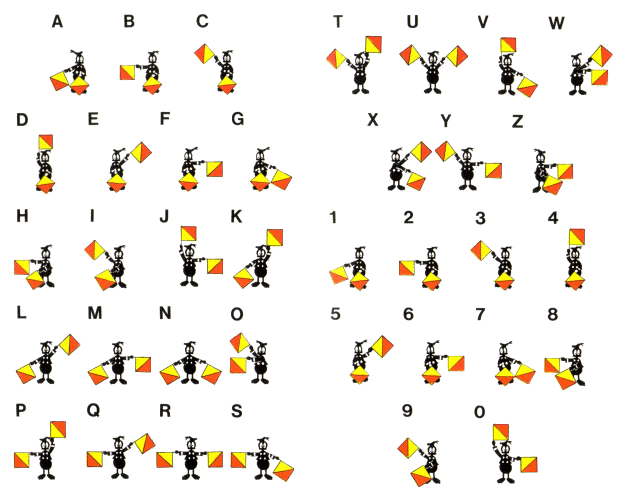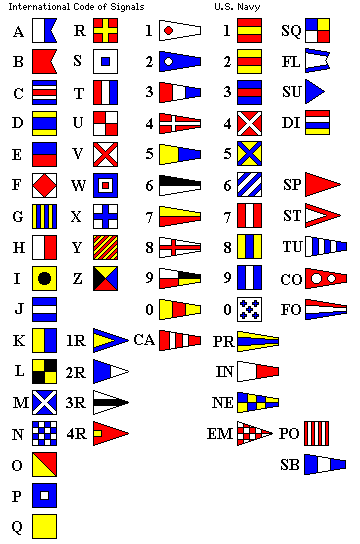Concernant l’Inscription, la Levée, la Paye et la Discipline des
Ouvriers nécessaires au service des ports et arsenaux de la Marine
Du 7 Ventôse, an XI de la République
Le gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre de la Marine et des colonies, le Conseil d’état entendu,
ARRÊTÉ :
Art. 1er Les administrateurs de la Marine préposés à l’inscription maritime, procéderont à un nouvel enregistrement des charpentiers de navires, perceurs, calfats, voiliers, poulieurs, tonneliers, cordiers et scieurs de long, exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes, et non inscrits comme marins.
II. Lorsque ces ouvriers seront appelés dans les ports et arsenaux maritimes, la levée s’en fera conformément à la loi du 3 brumaire an 4.
III. Si les besoins du service de la marine exigent que des ouvriers d’autres professions, tels que des forgerons, menuisiers et ouvriers des bâtiments civils , soient appelés dans les ports, ils seront tenus de s’y rendre sur la réquisition qui en sera faite par les administrateurs de la marine.
IV. Les ouvriers levés pour le service, recevront pour leur route, les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés.
- Ceux desdits ouvriers qui ne se rendront pas à leur destination, seront arrêtés et traduits dans les ports par la gendarmerie, de brigade en brigade.
- Les municipalités seront tenues de prêter main-forte, à la première réquisition des administrateurs de la marine.
- Les commissaires préposés à l’inscription maritime sont autorisés à établir garnison chez les ouvriers désobéissans ou déserteurs.
V. La paye des ouvriers sera fixée ainsi qu’il suit, à compter du 1er ventôse an 11 :
| Contre-maîtres |
1ère classe |
2 f. 30 c. |
| 2ème classe |
2 f. 00 c. |
| Aides-contre-maîtres |
1ère classe |
1 f. 80 c. |
| 2ème classe |
1 f. 70 c. |
| Ouvriers |
1ère classe |
1 f. 50 c. à 1 f. 60 c. |
| 2ème classe |
1 f. 35 c. à 1 f. 45 c. |
| 3ème classe |
1 f. 15 c. à 1 f. 10 c. |
| 4ème classe |
1 f. 00 c. à 1 f. 10 c |
| Apprentis |
|
0 f. 30 c. à 0 f. 80 c |
| Journaliers |
|
1 f. 00 c. à 1 f. 20 c |
Officiers-mariniers
employés aux travaux de garniture |
|
1 f. 35 c. à 1 f. 60 c. |
Matelots employés
aux travaux de garniture |
|
1 f.10 c. |
Mousses et Novices
employés aux travaux de garniture |
|
0 f.30 c. |
VI. Les ouvriers seront classés de manière que la totalité des taxes réunies ne puisse donner qu’une moyenne proportionnelle d’un franc 40 centimes par homme.
VII. Les ouvriers non inscrits qui seront appelés dans les ports par suite des levées extraordinaires, et conformément à la loi du 3 brumaire an 4 concernant l’inscription maritime, recevront, lorsqu’ils seront mariés ou père de famille, un quart en sus du salaire journalier auquel ils auront été taxés ; en supplément de salaire sera payé à leurs femmes, dans le lieu de leur domicile.
VIII.Conformément à l’arrêté du 17 ventôse an 5, le nombre des contre-maîtres et aides-contre-maîtres demeure fixé au vingtième des ouvriers de tous les ateliers pris en masse, non compris l’atelier de la garniture et les compagnies d’ouvriers.
- Les contre-maîtres employés actuellement dans les chantiers et ateliers, y pourront être maintenus ; mais il ne sera fait aucun remplacement parmi les diverses professions, que le nombre n’en soit réduit au vingtième sur la totalité.
- Les aides-contre-maîtres qui excèderont le nombre prescrit seront rangés dans la classe des ouvriers et payés comme tels, jusqu’à ce qu’ils puissent être admis de nouveau dans la classe des aides.
IX. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, le nombre des apprentis ne sera pas limité dans les classes de charpentier et de calfat, et on pourra les recevoir depuis 12 ans jusqu’à dix-huit ans.
Pour tout autre profession que celle de charpentier et de calfat , le nombre des apprentis sera fixé au huitième de celui des ouvriers de la même profession, pendant deux ans, et réduit au dixième après l’expiration de ces deux années : le surplus sera congédié que dans le cas où les apprentis excédans demanderaient leur licenciement, sinon la réduction sera faite par extinction. Ces apprentis seront reçus de douze à quinze ans.
Les apprentis seront divisés par nombre égal en quatre classes : le passage d’une classe à une autre ne pourra se faire que par remplacement.
Cette promotion sera faite, tous les ans, dans le mois de vendémiaire, d’après un examen fait authentiquement, en présence des officiers civils et militaires, et des maîtres entretenus dont dépendent les ateliers respectifs ; en outre, d’un capitaine de vaisseau ou de frégate, nommé par le préfet maritime, de l’inspecteur ou d’un sous-inspecteur, du commissaire ou sous-commissaire chargé des ateliers, et du commis chargé du détail.
Un apprenti qui aura passé deux années sans être jugé digne d’avancement, sera averti qu’on le révoquera l’année suivante, s’il n’a pas fait plus de progrès ; et s’il est en effet renvoyé, il sera tenu de servir trois ans comme journalier dans le port, ou comme novice sur les vaisseaux.
La préférence pour l’admission à l’apprentissage aura lieu dans l’ordre suivant :
- Aux fils d’ouvriers de la même classe ;
- Aux fils de marins, de militaires de mer et de terre, service ou morts au service ;
- Aux élèves des hospices.
X. Tout ouvrier qui saura exercer à-la-fois la profession de charpentier et celle de calfat, recevra un supplément de 10 centimes par jour, s’il est employé dans le port ou s’il est embarqué pour les deux profession.
Les apprentis charpentiers seront appliqués à-la-fois à la profession de charpentier et à celle de calfat.
Le supplément ci-dessus accordé ne sera point compté, lorsqu’il s’agira d’établir la paye moyenne, par homme, de 1 franc 40 centimes.
XI. Une somme de douze francs sera distribuée chaque mois, à raison de trois francs, à chacun des quatre ouvriers qui se seront distingués par leur application à leur talent.
Les noms des ouvriers qui obtiendront cette récompense seront affichés sur la porte du bureau du chef de service sous les ordres duquel ils seront employés, et sur celle du commissaire chargé du détail et des ateliers.
XII. La paye sera assignée à chaque ouvrier nouvellement arrivé, quand il n’aura pas sur son livret une taxe antérieurement établie légalement, qu’après vingt jours d’épreuve : si la fin du mois arrivait avant l’expiration de ces vingt jours, il recevrait une paye provisoire pour ce temps seulement et sauf rappel au mois suivant.
XIII. La fixation des taxes provisoires ou définitives, ainsi que les diminutions de paye dont les ouvriers se rendraient susceptibles par leur négligence, auront lieu sur le rapport du chef de service et du commissaire des chantiers et ateliers dont les ouvriers dépendent.
Il y a lieu à rectification seulement pour l’augmentation, mais non pour la diminution de la taxe, au mois de vendémiaire suivant, par la commission dont il est parlé article IX.
XIV. Nulle augmentation ou diminution de taxe provisoire ou définitive, faite dans le cours de l’année, ou faite et rectifiée au mois de vendémiaire, n’aura lieu que d’après la décision et approbation du préfet maritime.
XV. Tous les copeaux provenant de l’ébauche et dégrossi des bois de construction et autres, seront journellement ramassés et empilés pour être transportés dans un lieu séparé, et être vendu au profit de la République , ou employés à chauffer les pigoulières, étuves et corps-de-garde.
Les menus copeaux qui ne pourront être utilement employés, seront également mis à part pour être distribués aux ouvriers, en présence du chef de service et du commissaire préposé aux chantiers et ateliers, ou de leurs préposés.
Le jour et l’heure de cette distribution seront indiqués à l’avance, et l’enlèvement du bois ne sera annoncé qu’une demi-heure avant la sortie du travail.
Tous les ouvriers du port, à l’exception des apprentis participeront à cette distribution.
La moitié de ces menus copeaux sera réservée pour être vendue publiquement chaque mois, et le produit de cette vente sera distribuée aux ouvriers du port dont les familles seront les plus nombreuses. Le rôle de cette distribution sera arrêté par le préfet maritime, sur la proposition des chefs de service et du commissaire des chantiers et ateliers.
XVI. Les ouvriers qui ayant été levés pour le service des ports et arsenaux, déserteront, ou s’écarteront du port de plus de deux lieues sans permission, encourront la peine de huit jours de prison, et ils seront obligés à travailler dans le même port pendant six mois de plus.
Ceux qui s’absenteront pendant huit jours sans permission, seront réputés déserteurs, punis comme tels, et privés de leur paye et demi-solde, même en cas d’amnistie.
XVII. Les ouvriers qui n’auront pas répondus à l’appel, quel que soit le motif de leur absence, hors de maladie dûment constaté, ne jouiront d’aucune solde jusqu’à ce qu’ils aient repris leur travail.
XVIII. Les ouvriers domiciliés qui s’absenteront, pendant trois jours de suite, pour tout autre motif que celui de maladie dûment constaté, ou sans permission expresse du chef de service, seront renvoyés du port.
XIX. Les ouvriers de levée qui se seront absentés du port sans permission, pendant trois jours au plus, sauf le cas de maladie, seront détenus pendant autant de jours qu’ils auront été absens , sans préjudice des cas prévus par les lois sur la désertion.
XX. Il sera alloué six francs de gratification aux gendarmes qui arrêteront un ouvrier déserteur, et l’auront ramené dans le port où il était employé, ou l’auront remis à la disposition du commissaire ou sous-commissaire préposé à l’inscription maritime, dans le quartier auquel le déserteur appartient.
Le montant de cette gratification serra retenu sur la solde qui pourra être due à l’ouvrier.
XXI. Tout ouvrier malade sera traité dans les hospices aux frais de la République ; et pendant son séjour dans lesdits hospices, dûment constaté par les rôles des journées d’hôpitaux, il jouira de la moitié de sa paye.
XXII. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé BONAPARTE.
Par le premier Consul : Le secrétaire d’état, Hugues B. MARET.
Pour copie conforme :
Le Ministre de la marine et des colonies,
DECRÈS
E X T R A I T
Des Registres des Arrêtés et Décisions de la Préfecture du Département des Hautes-Pyrénées
Du 8 Germinal, an XI de la République française
LE PREFET DES HAUTES-PYRÉNÉES,
Vu l’arrêté du Gouvernement, du 7 ventôse an II, concernant l’inscription, la levée, la paye et la discipline des ouvriers nécessaires au service des ports et arsenaux de la marine.
ARRÊTE :
Art. 1er Les Sous-préfets, Maires et Adjoints des communes de ce département, se conformeront exactement, chacun en ce qui les concerne, aux articles III et IV, relatifs aux réquisitions des ouvriers de bâtiments civils qui leur seront faites par les administrateurs préposés à l’inscription maritime, ainsi qu’aux secours que les municipalités seront tenues de leur fournir, tant pour l’établissement des garnisons, que pour l’arrestation et la conduite par la gendarmerie des ouvriers, désobéissans et déserteurs.
II. L'arrêté du Gouvernement précité sera imprimé avec le présent, en nombre suffisant d’exemplaires ; pour être publié et affiché aux formes ordinaires, dans toutes les communes du département.
Le Préfet des Hautes-Pyrénées,
Signé J.-P. CHAZAL
Pour extrait conforme :Le Secrétaire-général
Charles SAINT-PAUL
A TARBES, Chez F. LAVIGNE, Imprimeur de la Préfecture.
Texte transcrit dans la graphie d’origine.
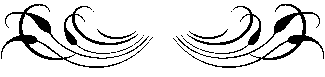
Équipage d'un vaisseau de 74 canons
749 hommes, hors officiers majors étaient nécessaires à l'armement d'un vaisseau de 74 canons
67 officiers mariniers, dont :
- 27 pour la manœuvre
- 7 pour le pilotage
- 33 pour le canonnage
16 maîtres et ouvriers, dont :
- 6 charpentiers
- 6 calfats
- 4 voiliers
326 matelots dont :
- 82 novices
- 72 mousses
- 20 surnuméraires
- 20 domestiques
- 16 garde-côtes
- 43 officiers et soldats de marine
- 87 officiers et fusiliers de l’armée
Pour en savoir plus :
- Les officiers bleus dans la Marine Française au XVIIIe siècle – AMAN Jacques – 1976
- La Royale : vaisseaux et marins du Roi-Soleil – DESSERT Daniel – 1996
- La Bretagne maritime aux XVIIIe et XIXe siècles, administration et archives, in Mémoires de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, tome LXIV – HENWOOD Philippe – 1987
- La famille Le Duic, trois siècles d’aventures maritimes et de pêches en Bretagne sud – DUIC Christian – 2002
- Les Bretons sur les mers – LE BOUEDEC - éditions Ouest-France – 1999
- Histoire de la Marine – LAVAUZELLE Charles - 1983
Échelle de BEAUFORT
Chiffre Beaufort |
Vitesse (km/h) |
Effets observés |
0 |
< 1 |
Calme, la fumée s'élève verticalement |
1 |
1 - 5 |
Le vent incline la fumée |
2 |
6 - 11 |
On perçoit le vent sur la figure |
3 |
12 - 19 |
Le vent agite les feuilles |
4 |
20 - 28 |
Le vent soulève poussière et papiers |
5 |
29 - 38 |
Le vent forme des vagues sur les lacs |
6 |
39 - 49 |
Le vent agite les branches des arbres |
7 |
50 - 61 |
Le vent gêne la marche d'un piéton |
8 |
62 - 74 |
Le vent brise des petites branches |
9 |
75 - 88 |
Le vent arrache cheminées et ardoises |
10 |
89 - 102 |
Graves dégats, tempête |
11 |
103 - 117 |
Ravages étendus, violente tempête |
12 |
> 117 |
Ouragan, catastrophe |
Sémaphore à deux bras
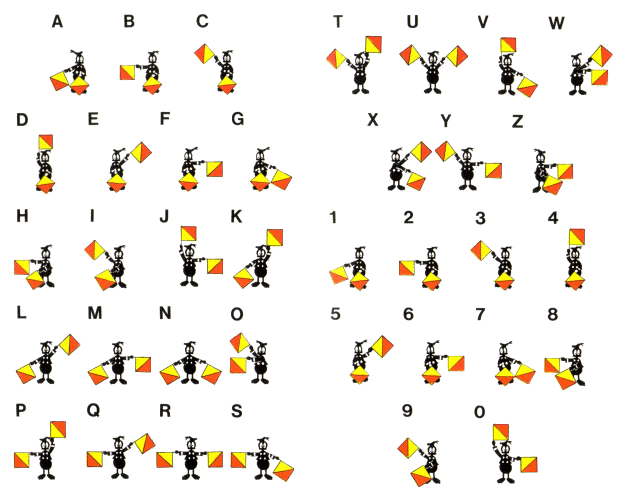
Signaux maritimes internationaux